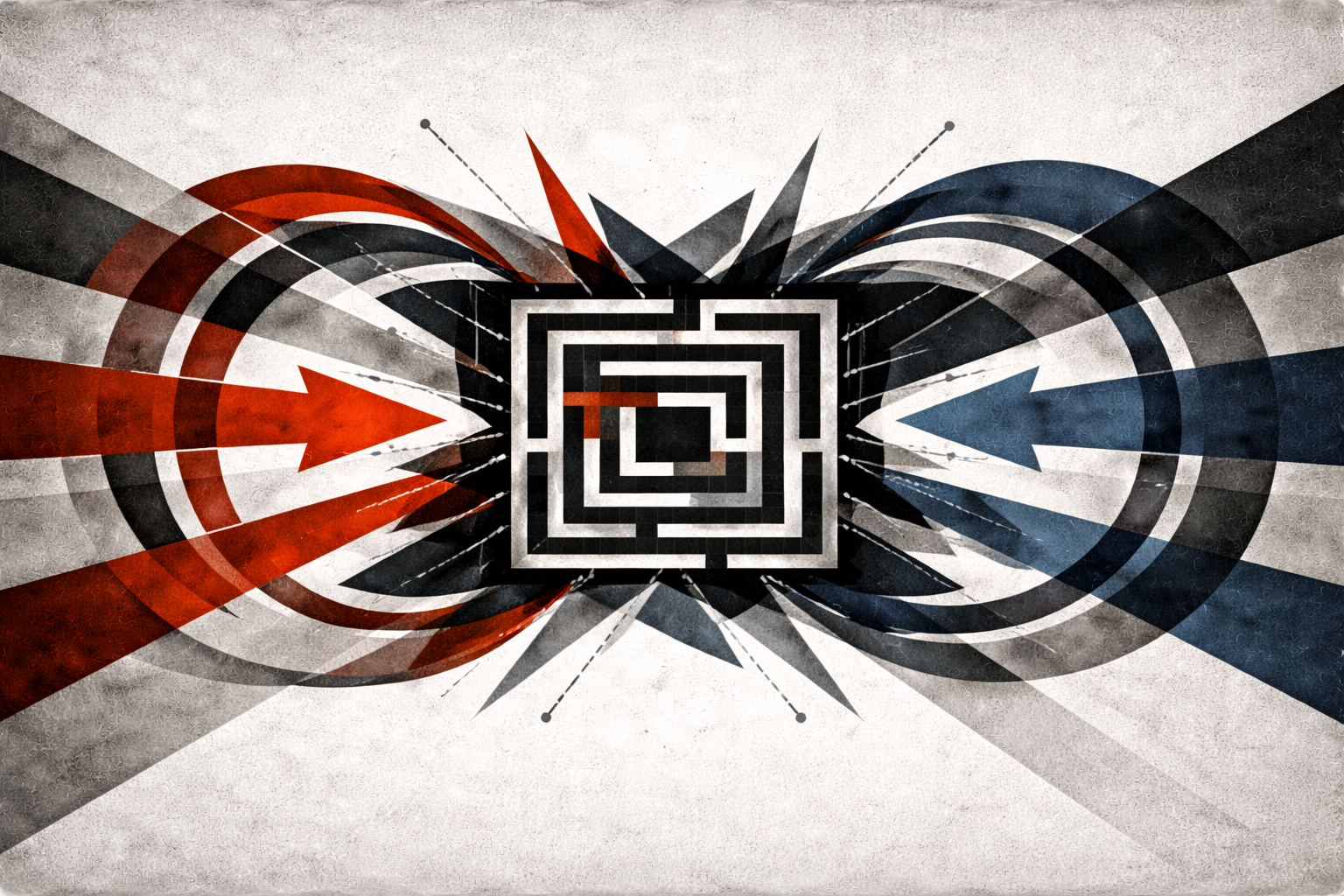Avant-propos
Il ne s’agit pas ici de contester pour contester, ni de remettre en cause une carrière, mais plutôt de s’interroger une grille de lecture dont les fondements ne tiennent plus. Aujourd’hui, Pascal Boniface incarne un courant analytique qui traverse une partie des cercles géopolitiques français : celui qui refuse d’actualiser ses grilles de lecture face aux évolutions brutales des rapports de force contemporains. Pourtant, Pascal Boniface a longtemps incarné cette fonction salutaire d’empêcheur de tourner en rond, en interrogeant les angles morts des récits dominants. C’est justement pour cette raison que sa position actuelle interroge : l’histoire l’a placé dans le rôle qu’il dénonçait, et il appartient désormais à d’autres de prolonger ce geste — y compris contre lui. À travers cette figure emblématique, c’est donc une critique systémique du champ analytique français que nous proposons.
I. Une lecture des intentions russes déconnectée du réel
Le faux diagnostic sur les motivations du Kremlin
Dans sa vidéo du 11 juillet 2025 intitulée « Pourquoi Poutine refuse l’offre de Trump sur l’Ukraine ? », Pascal Boniface avance l’hypothèse selon laquelle « Moscou semble engagée dans une logique de maximisation des gains militaires et politiques. Le Kremlin estime que l’Ukraine est prête à céder, qu’il peut engranger des conquêtes territoriales et provoquer un changement de régime ». Cette lecture présentée comme rationnelle passe à côté d’une réalité fondamentale : pour le Kremlin, la guerre n’est plus un simple dérèglement à corriger. Elle est devenue un état naturel de fonctionnement.
L’erreur est donc double. D’abord, elle sous-estime la capacité du pouvoir russe à grimer toute situation désavantageuse en victoire narrative. Le régime ne craint pas d’avoir à justifier les évolutions du conflit : il dispose des instruments de propagande pour présenter même un recul comme un succès stratégique, comme il l’a fait avec le retrait de Kherson ou l’échec de la prise de Kiev. Narrateur et commentateur des faits pour son public, il décide de la réalité des faits, sans contradiction. Ensuite, cette analyse ignore la logique profonde du système poutinien : la guerre est devenue le but de la guerre, car elle structure l’ordre interne et garantit l’inertie du régime.
Cette approche révèle également la persistance d’un cadre d’analyse occidental classique qui projette ses propres logiques sur un adversaire qui fonctionne selon d’autres logiques. Quand Boniface évoque une « logique de maximisation », il applique un raisonnement de type coûts-bénéfices là où le Kremlin opère selon une logique de survie systémique.
L’aveuglement collectif des analystes français
Cette erreur de diagnostic n’est pas isolée. Elle s’inscrit plutôt dans un travers diffus du champ analytique français : nous appliquons une rigueur critique sélective selon les acteurs étudiés. Les intentions américaines sont déconstruites, les stratégies de l’OTAN disséquées, car elles nous sont compréhensibles. Mais lorsqu’il s’agit du Kremlin, tout est présenté comme une réaction légitime, ou un simple malentendu.
Ce double standard révèle l’influence persistante d’un tropisme qui peine à intégrer les évolutions géopolitiques contemporaines. De nombreux analystes formés dans les années 1970-1980 continuent d’appliquer des grilles d’analyse forgées dans le contexte de la guerre froide, où la critique de l’hégémonie américaine constituait un angle mort nécessaire et légitime. Aujourd’hui, cette posture devient un handicap analytique lorsqu’elle nous empêche de voir les dynamiques impérialistes assumées d’autres puissances.
II. Une mésinterprétation de la stratégie diplomatique ukrainienne
La méprise sur les signaux de Kiev
Pascal Boniface interprète régulièrement les gestes d’ouverture diplomatique de la présidence ukrainienne comme les signes d’un basculement stratégique. Dans son analyse d’avril 2024, il suggèrait déjà que « Volodymyr Zelensky était prêt à faire un compromis avec Vladimir Poutine qui aurait remis les questions territoriales à plus tard au profit d’un cessez-le-feu immédiat », ajoutant : « L’Ukraine ne serait-elle pas en meilleure position aujourd’hui si elle avait accepté ces compromis jugés honteux à l’époque ? »
Cette lecture passe à côté de la finesse de la diplomatie ukrainienne, bien mieux expérimentée et armée que nous pour naviguer dans le brouillard de guerre diplomatique du Kremlin. Lorsque Zelensky évoque la possibilité de discussions, ce n’est pas pour concéder, mais pour exposer l’inflexibilité russe. Cette ouverture constitue une démonstration destinée à révéler les véritables intentions du Kremlin et à déjouer les accusations d’intransigeance ukrainienne. Comme l’a clairement réaffirmé le président ukrainien en juin 2025 : « Notre délégation n’a pas le mandat pour discuter la souveraineté et l’intégrité territoriale » (Meduza, 11 juin 2025).
Cette confusion savamment suggérée et poussée par le Kremlin finit par alimenter l’idée que la solution est à portée de main, si seulement l’Ukraine faisait un pas supplémentaire. C’est donc une faute majeure que de se laisser guider sur cette lecture, quand la réalité des faits démontre la vacuité de cette interprétation.
Il ne faut pas sous-estimer les « petits » acteurs
Cette méprise révèle un défaut plus profond : la tendance de nombreux analystes occidentaux à considérer les acteurs « périphériques » comme moins sophistiqués dans leurs stratégies. L’idée que la diplomatie ukrainienne puisse être plus subtile que ne le suggèrent ses déclarations publiques semble échapper à certains observateurs.
Ce biais s’étend à l’ensemble du champ analytique français, et même au-delà. Une vision hiérarchisée des capacités stratégiques persiste, selon laquelle seules les grandes puissances seraient capables de manœuvres diplomatiques élaborées. Cette approche conduit à sous-estimer systématiquement les États « moyens » et à mal interpréter leurs signaux.
III. La cristallisation d’un paradigme obsolète :
le postulat des concessions territoriales
L’idéologie du « pragmatisme »
Le cœur de l’erreur bonifacienne réside dans un postulat ancien qui resurgit à chaque crise : l’idée selon laquelle la paix devrait fatalement passer par des concessions territoriales. Dans son analyse d’avril 2024, il écrivait : « Un cessez-le-feu, à l’heure actuelle, signifierait le maintien de conquêtes territoriales opérées par la Russie depuis le 24 février 2022 et même depuis 2014 puisque la souveraineté de la Russie sur la Crimée n’est pas reconnue ». Pourtant, il s’interroge : « Peut-être qu’un jour l’Ukraine acceptera cela. Et pour quels résultats la guerre aura-t-elle été prolongée ? Pour des morts supplémentaires tant du côté ukrainien que du côté russe ».
Ce raisonnement, présenté comme un pragmatisme lucide, passe complètement à côté des enseignements de l’histoire récente. Car chaque territoire abandonné, qu’il s’agisse de la Tchétchénie, de la Géorgie, de la Crimée, et encore du Donbass, n’a pas stabilisé la situation. Au contraire, ils ont été perçus comme autant de signaux d’impunité, préparant le conflit suivant. Comme le souligne Marlene Laruelle, la normalisation du précédent géorgien a préparé le terrain pour la Crimée, qui elle-même a nourri l’intervention dans le Donbass.
Cette logique repose sur une mécompréhension fondamentale : elle confond paix et interruption, négociation et capitulation. Elle ignore la dynamique impérialiste assumée du régime russe et applique des principes de résolution classique à un acteur qui ne vise pas la résolution, mais la révision de l’ordre international.
L’illusion persistante du « dialogue avec Moscou »
Cette approche s’appuie sur un mythe tenace, celui selon lequel la Russie n’aurait pas été « considérée » par l’Occident. Boniface, comme d’autres, développe régulièrement cet argument en suggérant que « la politique américaine a beaucoup fait pour antagoniser Poutine et lui donner le sentiment que la Russie avait été humiliée après la fin de la Guerre froide ».
Or cette affirmation est démentie par des décennies de coopération : la création du Conseil OTAN-Russie en 1997, l’admission au G8, les multiples « reset » diplomatiques, les partenariats énergétiques européens. À chaque étape, Moscou a fini par détourner, geler ou instrumentaliser ces ouvertures. Ce n’est pas le manque de dialogue qui a mené à l’agression, c’est l’agression qui a sapé le dialogue.
La généralisation du syndrome dans le champ analytique français
Ce réflexe de l’excuse, travesti en lucidité stratégique, traverse l’ensemble du champ géopolitique français. Il révèle la persistance d’une culture analytique qui privilégie systématiquement l’explication par les « causes profondes » occidentales, causes qu’il n’hésite pas à créer de toute pièce si elles manquent à son raisonnement, plutôt que de simplement admettre la responsabilité des acteurs non-occidentaux.
De l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) au Monde Diplomatique, nombreux sont les commentateurs et analystes qui reproduisent cette grille de lecture. Cette approche témoigne d’une difficulté à intégrer la fin de l’exceptionnalisme occidental sans tomber dans l’angélisme envers ses challengers.
IV. La dérive méthodologique : quand l’erreur devient système
L’incapacité à la remise en cause
Ce qui frappe chez Pascal Boniface, comme chez nombre de ses pairs, ce n’est pas tant l’erreur initiale que l’incapacité à la corriger. Ainsi, malgré l’invasion du 24 février 2022 qui contredisait frontalement ses pronostics (il déclarait dans L’Echo le 24 décembre 2021 que « la Russie n’a aucune envie de conquérir le Donbass, dont elle ne saurait pas faire grand-chose » et évoquait une « hystérisation de la politique américaine à l’égard de Moscou ») le cadre interprétatif demeure inchangé.
Cette rigidité révèle une dérive professionnelle profonde et dangereuse : le passage de l’analyse à la défense d’une ligne. Quand le réel contredit le modèle, c’est le réel qui est réinterprété pour sauver le modèle. Cette démarche transforme l’analyste en commentateur idéologique, compromettant sa fonction d’éclairage du débat public. Pire, elle nous rend aveugle, en ceci que nous sommes entretenus dans l’impression de toujours suivre une analyse souveraine et réaliste, là où il n’y a plus qu’un écho de la diplomatie adverse.
L’enjeu de la parole d’autorité
Cette dérive n’est pas seulement intellectuelle mais institutionnelle. Elle devient politique dès lors qu’elle confère une apparence de légitimité à des récits stratégiques promus par des puissances hostiles. En ne prenant pas acte des dynamiques profondes du régime russe, certaines analyses cautionnent parfois, malgré elles, un narratif d’équivalence morale qui affaiblit la compréhension des enjeux.
L’autorité médiatique acquise par certaines figures analytiques leur confère une responsabilité particulière. Quand leurs analyses se révèlent systématiquement fausses sur des enjeux majeurs, c’est la crédibilité de l’ensemble du champ qui s’en trouve affectée. Il devient donc nécessaire, pour les institutions comme pour les observateurs, de réévaluer les figures qu’elles ont consacrées.
V. Le Monde Diplomatique : laboratoire de l’erreur systémique
Un cas d’école de déformation analytique
Le mensuel dirigé par Serge Halimi illustre parfaitement les dérives évoquées à travers l’exemple de Pascal Boniface. La couverture du conflit ukrainien par Le Monde Diplomatique révèle les mêmes biais structurels, mais de manière plus assumée et systématique.
Dans leur article de mars 2023 « Les médias, avant-garde du parti de la guerre », Serge Halimi et Pierre Rimbert trouvent le moment propice pour pointer surtout la menace de l’hégémonie américaine, tout en développant « une campagne en faveur de la destruction économique et militaire de la Russie ». Cette approche reflète exactement la même inversion des priorités analytiques : au lieu d’analyser l’agression russe, l’accent est mis sur la critique de la réponse occidentale.
Plus révélateur encore, la couverture de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, notamment des éditoriaux de Serge Halimi et Pierre Rimbert, sont critiqués par Médiapart en novembre 2022 comme reprenant « des arguments typiques de la rhétorique poutiniste sur la présence nazie en Ukraine », ainsi que pour leur mise en cause des sanctions économiques occidentales, ou la question de l’envoi d’armes à l’Ukraine.
La méthode diplomatique : une symétrie pathologique
La stratégie du Monde Diplomatique consiste à noyer l’agression russe dans une mise en perspective historique qui finit par la relativiser. Comme le note Politis dans sa réponse aux accusations du « Diplo » : « À trop vouloir invoquer les injustices et les crimes d’hier, et d’ailleurs, on risque de relativiser la tragédie ukrainienne ».
Cette méthode révèle une conception particulière du journalisme « critique » qui consiste à systématiquement chercher les responsabilités occidentales dans chaque crise internationale. Halimi et Rimbert invoquent le rapport Wolfowitz de 1992 quand, ivres de leur puissance, les néoconservateurs affirmaient que « l’ordre international est en définitive garanti par les États-Unis ». Mais comme le souligne justement Politis, « le monde a bien changé en trente ans. Si les États-Unis sont toujours la première puissance militaire, ils sont contestés par la Russie, la Chine et même la Corée du Nord ».
L’instrumentalisation de la critique médiatique
Le Monde Diplomatique va plus loin en développant une critique des médias occidentaux qu’il accuse d’être devenus « l’avant-garde du parti de la guerre ». Cette posture permet d’évacuer le débat sur le fond sur l’agression russe et ses conséquences, au profit d’une critique de forme sur le traitement médiatique.
Cette stratégie n’est pas neutre : elle participe d’un écosystème narratif qui minimise l’agression russe en déplaçant le focus sur les « excès » de la solidarité occidentale avec l’Ukraine. L’influence du mensuel, particulièrement dans les milieux éducatifs et intellectuels de gauche, amplifie l’impact de cette déformation analytique.
Un réseau d’influence convergent
L’exemple du Monde Diplomatique révèle l’existence d’un réseau analytique qui partage les mêmes biais et se renforce mutuellement. L’Observatoire du journalisme, association d’extrême droite de critique des médias, rédige plusieurs textes élogieux sur le journal, notamment pour sa critique de « l’OTAN et de l’Union européenne tout en promouvant la neutralité dans le conflit ».
Cette convergence entre extrême gauche et extrême droite sur la question ukrainienne n’est pas fortuite : elle révèle un socle commun de critique de l’ordre occidental libéral qui transcende les clivages politiques traditionnels. Pascal Boniface, Le Monde Diplomatique et leurs héritiers participent, consciemment ou non, de cet écosystème narratif.
Conclusion : l’urgence d’une refondation analytique
Diagnostic : l’échec d’une génération d’analystes
Le cas de Pascal Boniface, amplifié par l’exemple du Monde Diplomatique, révèle l’échec d’une partie d’une génération d’analystes à comprendre les mutations géopolitiques contemporaines. Formés dans un monde bipolaire où la critique de l’hégémonie américaine constituait un nécessaire contrepoids, ils peinent à intégrer un monde multipolaire où d’autres puissances développent leurs propres logiques impérialistes.
Cette génération a construit sa légitimité sur la dénonciation des « aventures » occidentales, posture qui était souvent justifiée. Mais elle se révèle inadaptée face à des défis géopolitiques qui ne rentrent plus dans cette grille de lecture précise. L’agression russe contre l’Ukraine, après celles en Géorgie et en Tchétchénie, constitue un ultime test révélateur : elle expose l’inadéquation de paradigmes analytiques devenus largement obsolètes.
L’enjeu démocratique de la qualité analytique
Cette crise analytique dépasse les cercles d’experts : elle affecte la capacité démocratique à comprendre le monde contemporain. Quand les figures d’autorité du champ géopolitique français se trompent systématiquement sur les enjeux majeurs, c’est l’ensemble du débat public qui s’en trouve affaibli.
À l’heure où la guerre ne se joue plus seulement sur les champs de bataille mais dans les esprits et les récits, il ne s’agit plus seulement d’avoir raison : il s’agit d’être lucide, réellement. Les sociétés démocratiques ont besoin d’analyses fiables pour éclairer leurs choix, sans quoi l’erreur originelle deviendrait une défaillance civique profonde.
Vers un renouvellement nécessaire
La refondation du champ analytique français passe par plusieurs exigences : d’abord, l’acceptation que les grilles de lecture forgées au XXe siècle ne suffisent plus à comprendre les enjeux du XXIe. Ensuite, la reconnaissance que la critique de l’Occident, si nécessaire soit-elle, ne doit pas conduire à l’angélisme envers ses challengers. Enfin, l’exigence que l’analyse géopolitique retrouve sa fonction première, c’est à dire éclairer le réel plutôt que défendre une ligne tracée.
Cette refondation implique aussi de nouveaux critères d’évaluation : la capacité prédictive, l’adaptation aux faits nouveaux, la remise en cause des paradigmes défaillants. Il s’agit de passer d’un champ analytique fondé sur l’autorité acquise à un champ fondé sur la pertinence démontrée.
Car lorsque l’erreur se prolonge, se réplique, se durcit au lieu de s’amender, elle cesse d’être une simple divergence d’interprétation pour devenir un angle mort systémique. Et dans un monde en mutation rapide, les angles morts deviennent des pièges fatals.