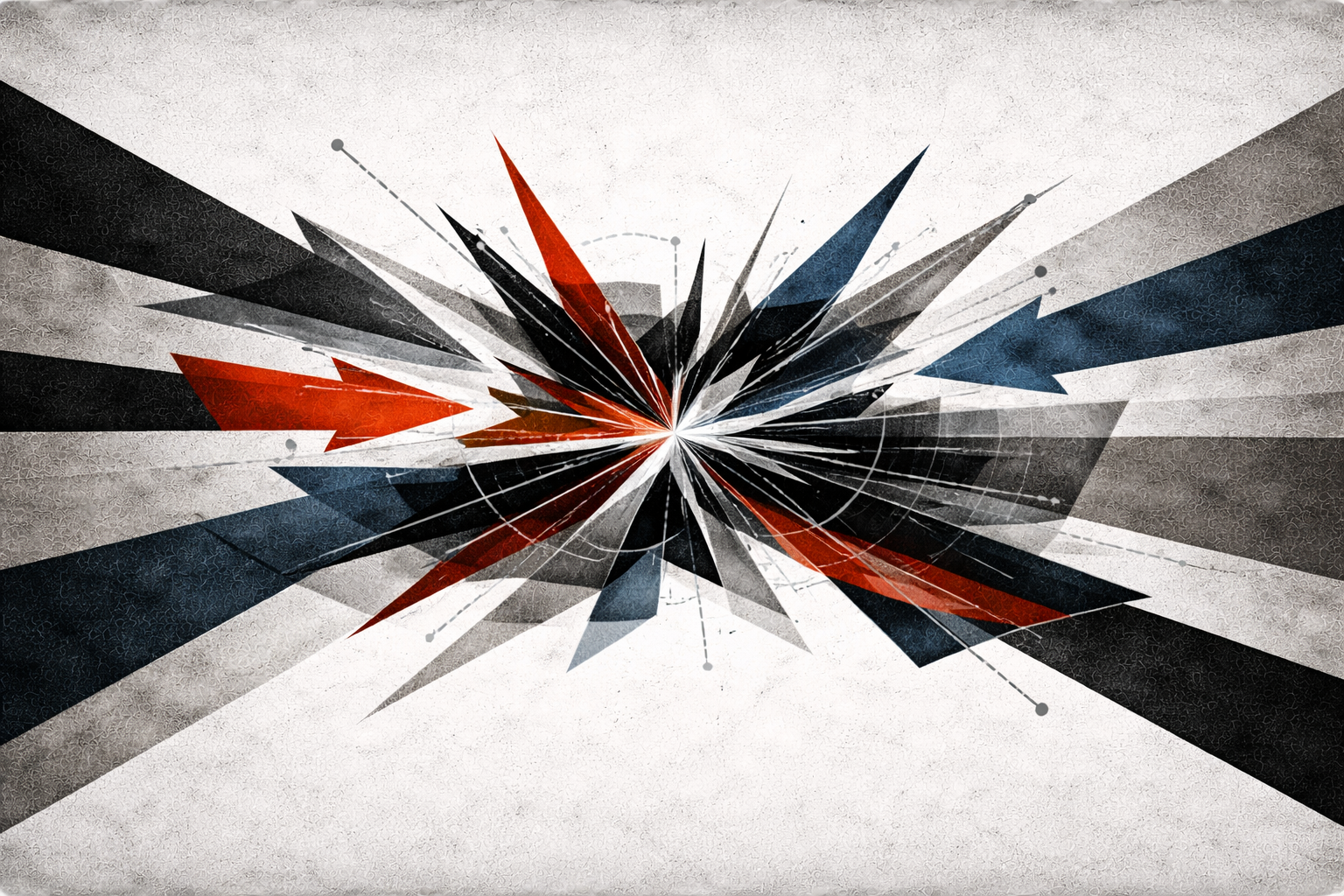Avant-propos
Il convient d’abord de saluer le travail remarquable du Monde et de Sébastien Bourdon dans la couverture du conflit ukrainien. Traiter ce sujet sous tous ses angles, y compris les plus dérangeants, relève d’une exigence journalistique essentielle qui n’est jamais facile à assumer. Cette enquête vidéo, méthodique et rigoureuse, témoigne de cette volonté de ne pas édulcorer une réalité complexe, même lorsqu’elle peut alimenter des instrumentalisations. C’est précisément parce que ce travail mérite respect et attention qu’il appelle aussi un éclairage complémentaire.
L’enquête vidéo du Monde affirme avoir « identifié plusieurs centaines de soldats ukrainiens arborant des symboles nazis, notamment au sein de la 3ᵉ brigade d’assaut ». Cette observation, « rigoureusement documentée », soulève une série de questions légitimes mais mérite d’être resituée dans son contexte historique, sociologique et stratégique pour éviter tout raccourci.
Nationalisme en première ligne : effet de concentration
Le reportage insiste : « Nous avons repéré des saluts nazis, des croix gammées, des emblèmes de la SS sur les uniformes ou tatouages de centaines de combattants ». Ce chiffre — « plusieurs centaines » — concerne, selon la vidéo, une « concentration notable au sein de la 3ᵉ brigade d’assaut », héritière du bataillon Azov.
En temps de guerre, il est courant que les éléments les plus radicaux et les nationalistes convaincus convergent vers les unités de première ligne. Comme l’explique l’historien Anton Shekhovtsov, « les conflits armés tendent à attirer une surreprésentation d’individus issus de mouvances extrémistes, sans que cela ne reflète la société civile dans son ensemble » (Russia and the Western Far Right: Tango Noir, Routledge, 2018). Les chiffres électoraux le confirment : lors des législatives ukrainiennes de 2019, l’extrême droite n’a réuni que 2 % des suffrages, et seulement 1,6 % à la présidentielle (source : OSCE, 2019 ; Shekhovtsov, 2021). Ce contraste entre leur visibilité militaire et leur marginalité politique est documenté dans plusieurs travaux universitaires (ex : Pikulicka-Wilczewska & Sakwa, Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives, 2015), et s’explique aussi par le travail de propagande ennemie, par exemple depuis 2014 avec l’opération Secondary Infektion qui fait l’objet d’un rapport documenté par Graphika.
Symboles : distinguer usage, origine et signification
La vidéo du Monde précise s’être « concentrée sur les symboles explicitement nazis : croix gammée, 88, Totenkopf, emblèmes SS », excluant volontairement les symboles d’origine nordique ou païenne souvent présents dans l’imaginaire nationaliste européen. Sur ce point, la nuance est essentielle, et la note des sources sur cryptpad exprime bien cette précaution salutaire. De nombreux travaux de sciences sociales (cf. Per Anders Rudling, « The Return of the Ukrainian Far Right », New Eastern Europe, 2019) soulignent que certains de ces symboles, comme le « wolfsangel » ou la rune « I », précèdent historiquement l’idéologie nazie et peuvent relever d’une récupération néo-païenne ou du rejet de l’influence russe plus que d’une adhésion à la doctrine nazie.
La vidéo elle-même reconnaît cette ambiguïté : « Le ‘wolfsangel’ inversé est aussi un ancien emblème de la culture ukrainienne, utilisé bien avant la Seconde Guerre mondiale ». Cela n’annule pas la portée potentiellement problématique de son usage actuel, mais souligne la nécessité de distinguer les référents symboliques pour éviter l’anachronisme ou la confusion.
Promesses d’assainissement vs. persistance des symboles
Le Monde rappelle que « la 3ᵉ brigade d’assaut avait pourtant promis de policer son image », mais constate que « certains de ses soldats continuent d’afficher une symbolique et des références nazies ». Cette tension entre communication officielle et réalité du terrain est documentée par plusieurs chercheurs (Shekhovtsov, 2022 ; Umland, 2019), qui soulignent la difficulté d’assainir rapidement l’image d’unités issues de l’histoire tourmentée de l’ultranationalisme ukrainien.
Il faut ici rappeler la divergence de perception : en Europe occidentale, le nazisme reste associé à une idéologie génocidaire, antisémite et autoritaire ; dans l’espace post-soviétique, il désigne avant tout l’ennemi occidental de la « Grande Guerre patriotique » (voir Serhii Plokhy, The Gates of Europe: A History of Ukraine, Basic Books, 2017). La propagande russe s’appuie systématiquement sur cette confusion sémantique pour accuser l’Ukraine de néonazisme, alors même que les éléments disponibles ne permettent pas d’identifier, dans ces unités, ni projet antisémite, ni volonté de régime autoritaire, ni intention génocidaire.
Symboles problématiques : un risque informationnel majeur
Il ne s’agit pas de minimiser la gravité de la présence de tels symboles. La vidéo du Monde démontre que ce problème existe et qu’il est exploité, notamment dans la guerre informationnelle. Comme le souligne la chercheuse Jade McGlynn : « La Russie instrumentalise chaque image, chaque témoignage de symboles nazis pour délégitimer la résistance ukrainienne et justifier sa propre guerre » (Russia’s War, Polity Press, 2023). L’Ukraine, en tolérant ces signes, même minoritaires, s’expose à une fragilisation majeure de sa légitimité internationale.
Pour une analyse qui évite le double piège :
banalisation ou instrumentalisation
La vidéo du Monde révèle une réalité documentée et problématique. Mais pour l’analyser sérieusement, il faut distinguer :
- la surreprésentation des extrêmes dans les unités combattantes,
- l’ambiguïté des symboles historiques dans un contexte de guerre identitaire,
- la discordance persistante entre communication officielle et pratiques de terrain,
- l’exploitation systématique de ces faits dans la guerre de l’information menée par la Russie.
L’approche rigoureuse impose de contextualiser sans excuser, et de distinguer la réalité du terrain de la narration instrumentalisée. C’est le seul moyen d’éviter à la fois la banalisation du phénomène et la manipulation médiatique qui en découle.